La multiplication de mises au grand jour des pratiques politiques maltraitant l’éthique et le coup de force quelque peu suicidaire du président du cdH a permis de lancer un grand débat sur une «nouvelle gouvernance». Ce terme de gouvernance est équivoque car il provient du monde des affaires qui entend remplacer les choix politiques, nécessairement subjectifs, par une rationalité très managériale.
Il importe donc de faire le tri entre réelles avancées démocratiques et propositions cosmétiques, voire contre-productives. En effet, comme l’a prouvé l’avènement de Jupiter Macron en France et comme le dit Alain Delon qui incarne un personnage du film Le Guépard reprenant une phrase de Guiseppe Di Lampedusa, «Il faut que tout change pour que rien ne change».
Interdire le cumul de mandats, limiter les émoluments des responsables politiques pour les rapprocher de la moyenne de ce que gagnent ceux qu’ils sont censés représenter, éliminer les structures devenues obsolètes comme les provinces, rationnaliser les conseils d’administration trop peuplés qui doivent gérer et contrôler les services publics (et au public) pour des intercommunales…, voilà des options qui sont incontestablement positives. Par contre, on voit, à l’occasion du remue-ménage dans nos institutions, surgir deux propositions qui sont plus que douteuses: supprimer l’effet dévolutif de la case de tête et réduire le nombre de mandats dans les assemblées (communales notamment). Il faut accepter de prendre un peu de temps pour comprendre ce qui peut se cacher derrière des propositions apparemment sympathiques.
Le vedettariat en politique
L’effet dévolutif de la case de tête est un processus de technique électorale assez complexe. On peut voter pour un candidat, que l’on apprécie personnellement mais on peut aussi voter «en case de tête», c’est-à-dire cocher la case non nominale au-dessus de la liste, ce que font environ 30% des électeurs.
C’est l’option de ceux qui votent pour le programme d’un parti et pas pour une personne. Pour l’attribution des sièges, ces voix (appelées «pot de la case de tête») sont reportées sur les candidats qui n’ont pas obtenu, grâce à leurs seules voix de préférence, le «quotient électoral» qui permet d’être élu. En pratique donc, ce système permet de faire élire des personnes bien placées sur la liste mais qui n’ont pas la notoriété suffisante pour parvenir à être élues grâce à leur statut de vedette politique. C’est très mal, disent les partisans qui estiment que ce n’est pas démocratique et que seuls doivent être élus ceux qui emportent le plus de suffrages sur leur seul nom.

Il est vrai que l’effet dévolutif permet à une formation politique, en mettant une personne assez haut sur la liste, de la faire élire. Toute la question est alors de savoir qui, au sein d’un parti, décide de faire progresser une personne sans qu’elle soit une vedette médiatique. Si c’est le président, le chef de section qui décide souverainement, il est vrai que c’est alors peu démocratique… et c’est ainsi qu’au sein des partis traditionnels on voit apparaître des apparatchiks. Par contre, si c’est une assemblée de militants qui choisit ceux qu’elle veut valoriser, on a la possibilité de donner leur chance à des candidates ou des candidats qui, par leur action ou leur dévouement ont su gagner la confiance de leurs pairs. Comme quoi, dans une démocratie représentative où les partis sont incontournables, il est important que des citoyens s’investissent dans les partis et se battent pour qu’une démocratie réelle s’instaure d’abord au sein de ceux-ci. C’est une condition préalable à l’amélioration de la démocratie au niveau supérieur. A l’opposé, certains leaders des formations dominantes voient donc dans le maintien de l’effet dévolutif un risque de mettre en péril la poursuite de leur présence sur le devant de la scène politique…
De plus, déjà aujourd’hui beaucoup de politiciens consacrent plus de leur temps à faire la promotion du produit qu’est leur propre image qu’à faire le boulot pour lequel ils ont été élus. Les «boudin-compote», bals du bourgmestre et autres «permanences sociales» ont de beaux jours devant eux si l’on peut faire carrière en politique grâce à l’auto-publicité. A moins, bien sûr, que l’on ne limite le nombre de mandats consécutifs, une autre mesure que refusent les «parvenus» accrochés à leur mandat.
Moins d’élus?
Les citoyens sont parfois choqués par le nombre de mandataires qui siègent dans une assemblée, qu’elle soit parlementaire, communale ou intercommunale… Comme ces gens sont rétribués (notamment via les fameux jetons de présence), certains s’inquiètent du coût pour la collectivité. C’est vrai que l’on pourrait faire quelques économies en diminuant le nombre de représentant, même si l’étude des budgets montre que le prix de la démocratie n’est qu’une fraction infime des dépenses des pouvoirs publics. Mais puisque ce sont les citoyens qui paient via leurs impôts, on pourrait envisager une réduction du nombre des mandataires mais deux conditions sont souhaitables pour que cela soit une réelle amélioration.
D’abord, il convient de s’assurer qu’il y ait suffisamment d’élus pour que les tendances politiques minoritaires soient représentées. En effet, en Belgique, le mode de scrutin prévoit une proportionnelle atténuée. Encore une technique électorale un peu compliquée, la règle D’Hondt (explication ici) qui fait que si l’assemblée est trop réduite, les tendances politiques minoritaires ou nouvelles ne pourront être représentées. Ainsi, la minorité néerlandophone du Parlement régional bruxellois, qui voyait son nombre diminuer d’élection en élection (baisse démographique des néerlandophones à Bruxelles) a obtenu, lors d’une réforme de l’Etat, que son nombre d’élus soient fixé à 17 députés (alors qu’ils n’étaient plus que 10) et ce afin d’être encore présents dans toutes les commissions où le véritable travail parlementaire se réalise. C’est ainsi que la Flandre qui critique le «trop grand nombre» de parlementaires, grâce au fait qu’elle est majoritaire en Belgique, a pu protéger «sa» minorité dans la capitale et a fait passer l’assemblée bruxelloise de 75 à 89 députés…
Cette nécessaire protection des minorités est encore plus sensible dans les conseils communaux où s’applique la règle électorale Imperiali qui favorise encore plus les grands partis. Appliquer la règle D’Hondt (produit d’exportation belge dans des pays qui, après la décolonisation, découvraient les subtilités de la démocratie) au niveau communal serait utile si l’on réduisait le nombre d’élus. En effet, ce sont les minorités qui, dans l’opposition, contrôlent la majorité et garantissent parfois l’absence de dérives.
Une seconde évolution positive serait d’accompagner une éventuelle réduction du nombre d’élus par le fait de leur donner les moyens d’assumer correctement leur mandat (formations, aide logistique…). Ainsi, un budget communal, ce sont des centaines et des centaines de pages de tableaux de chiffres et la maîtrise d’un tel outil aurait intérêt à être facilitée. Ceci est d’autant plus vrai pour les intercommunales où des élus au second degré doivent gérer des matières complexes, techniques dans lesquelles ils sont rarement experts. Les récentes affaires éthiques ont aussi montré que des faits répréhensibles étaient rendus possibles parce que les élus politiques (de la majorité comme de l’opposition) ne maîtrisaient pas leurs dossiers et étaient manipulés par l’administration et le sommet de l’institution qui, eux, y travaillent à plein temps alors que ceux qui sont sensés les contrôler ne peuvent y consacrer que quelques heures de temps en temps.
Le goût du pouvoir
Le vent de réforme qui souffle sur Bruxelles et la Wallonie suite à la mise à jour de trop nombreux scandales est une bonne chose et l’on peut espérer que cela améliorera à terme le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Il ne faut toutefois pas se tromper de cible. L’indignation vécue par les citoyens souvent en difficulté économique, face à des enrichissements personnels scandaleux, est salutaire. Mais il ne suffit pas d’éliminer les brebis galeuses et modifier les règles pour que l’épidémie soit jugulée. Il faut aussi que cela serve à rendre la gestion publique plus efficace, faute de quoi les «forces du marché» auront beau jeu de réclamer une privatisation de certaines activités et, alors, ce ne sont plus que quelques mandataires publics déviants qui s’enrichiront illégalement mais des actionnaires privés qui s’enrichiront bien plus et… tout à fait légalement.
Les résistances que l’on observe déjà face aux nécessaires changements viennent paradoxalement de ceux qui dénonçaient le plus violemment les errements de leurs adversaires politiques. La volte-face du parti centriste qui se découvre soudain des affinités avec la droite plutôt qu’avec la gauche est-elle motivée par une subite révélation idéologique ou s’explique-t-elle par un double calcul très prosaïque lié au goût du pouvoir:
– s’éloigner d’un partenaire en méforme et qui ne sera plus un bon allié pour rester aux affaires dans les temps qui viennent;
– abandonner ceux qui, trop marqués par les dérives, se sentent obligés de modifier en profondeur les règles du jeu, ce qui nuirait à ceux qui jouent sur le même terrain glissant?
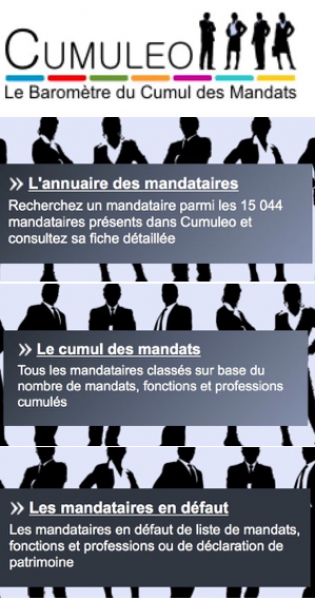
Ce serait l’objet d’un autre article, plus psychologique, mais ce serait très intéressant de s’interroger sur quel goût, si extraordinaire, cela a le pouvoir…


